Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
J’ai 30 ans, je suis professeur de Lettres dans un collège public de la grande banlieue parisienne depuis 4 ans. J’enseigne dans le même établissement depuis mes débuts. Je me destinais à travailler dans le monde de l’édition et je suis devenu professeur un peu par hasard. À l’époque, j’avais de nombreux amis qui étaient enseignants ou souhaitaient le devenir. À force de les entendre parler, ils m’ont mis la puce à l’oreille. J’ai fini par comprendre que ce métier était sans doute fait pour moi et… j’ai passé le Capes !
« Rappeler les enfants » est une succession de scènes de vie qui se déroulent dans votre classe. Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire ?
Bien souvent, les livres d’enseignants parlent surtout… de l’enseignant ! C’est lui qui est au centre. D’autres racontent les difficultés du métier, ce sont alors des livres de colère et de revendications souvent totalement justifiées, d’ailleurs. Mais enseigner ce n’est pas seulement faire face à des hordes de barbares en culottes courtes ou batailler contre l’administration ! Ce sont surtout des moments où se nouent des rapports humains extrêmement enrichissants.
Je déteste les “perles du bac” qui se focalisent sur la phrase rigolote, l’erreur sortie de son contexte jetée sur la place publique pour en ricaner collectivement. Ce qui m’intéresse, c’est exactement l’inverse. C’est de voir comment on arrive au moment où telle phrase, telle réflexion, telle question sont prononcées, tel comportement adopté. À travers ces scènes, j’essaye de montrer comment ce qui se passe avant le cours, pendant le cours et en dehors du cours construit le comportement de l’élève. Le comportement vis-à-vis du professeur, mais aussi des autres élèves.
Je parle très peu de moi dans le livre, car le plus intéressant, ce sont les élèves. Eux, dont on ne parle pas souvent, sinon avec des raccourcis réducteurs. Ce livre est d’abord une manière de garder une trace de ces “belles choses”, de ces moments de vie importants — heureux, tristes, mélancoliques, tragiques même parfois — qui se déroulent dans nos classes.
Après avoir passé une heure épouvantable avec des élèves, le risque est grand que je rentre chez moi en colère, déçu et fatigué… Si je n’y prends garde, cette heure-là va occulter toutes les autres. Il faut oser revenir sur ces jolies choses, oser se le dire à soi-même, et oser le dire aux autres.
Justement, pour qui avez-vous écrit votre livre ?
Au fur et à mesure de l’avancée du livre, je me suis adressé à un nombre croissant de lecteurs. Au départ, j’ai écrit pour mes amis et mes proches. Je voulais leur montrer ma réalité et casser quelques clichés sur le métier et les élèves de banlieue. Je me souviens que lorsque j’ai annoncé que j’allais devenir prof en banlieue, j’ai eu droit à deux types de réactions. Soit l’éternel : « Ah, tu vas être peinard avec tes 6 mois de vacances par an », soit « Mon pauvre avec toutes ces racailles, tu n’arriveras jamais à faire cours ». J’espère d’ailleurs que des jeunes qui envisagent de devenir profs trouveront dans le livre des raisons de persévérer dans cette voie. Pour revenir à la question, je me suis assez vite rendu compte que j’écrivais aussi pour mon propre bénéfice. Lorsque les professeurs ont fini leur journée, ils passent les 2 heures qui suivent à parler de leurs élèves, soit entre eux soit avec leurs amis… au risque de finir par les saouler ! Moi, mon médium de prédilection c’est l’écrit. Le livre est donc aussi un exutoire. Enfin, j’ai écrit ce livre pour les parents d’élèves et pour les enfants de ces générations que j’ai en classe.
Vous dites que votre livre est un roman. Pourquoi ?
Le livre ne ment ni sur les mots employés ni sur les situations. Mais c’est un roman car je ne veux pas raconter « mes élèves », mais des élèves crédibles. J’ai fait un pas de côté pour respecter leur intimité. C’est un roman aussi parce qu’il y a une ambition littéraire derrière. Je fais très attention aux mots que j’emploie, à la construction de mes phrases, au rythme. C’est un roman encore, parce qu’il raconte une histoire, je n’ai pas une approche documentaire. Évidemment, cela ne repose pas sur une intrigue, néanmoins le lecteur va lire des scènes qui ont un début, un milieu et une fin et, qui parfois, se répondent l’une l’autre.
On pouvait déjà vous lire sur votre compte Facebook. Ces billets ne vous suffisaient plus ?
Ce sont des outils complémentaires. Sur Facebook, c’est une construction permanente alors que le livre est, par essence, un modèle fini, achevé. Les billets sur Facebook s’écrivent au jour le jour, sans le recul que j’ai pris pour le livre. Certaines histoires sur Facebook peuvent commencer sans s’achever. Le fait d’écrire presque au quotidien sur Facebook était déjà pour moi une pratique pédagogique. Revenir sur ce que j’ai vécu dans la journée me permet de voir de comprendre à quel moment du cours quelque chose s’est joué.
Dans votre livre on vous voit assez peu enseigner. La mosaïque des échanges que vous présentez porte surtout sur des questions de société (politique, religion, vivre ensemble, droits, tolérance, racisme…). Pourquoi, la transmission du savoir, le cours proprement dit, sont-ils si peu présents ?
Ces sujets d’éducation, disons plus « sociétaux », que vous mentionnez, je les aborde tous les jours ou presque dans ma pratique d’enseignant. Je ne triche donc pas en les racontant. Toutefois, ils ne constituent évidemment pas la majorité du temps d’échanges que j’ai avec mes élèves. Que les parents se rassurent, l’essentiel des heures est évidemment consacré au programme, à la lecture des auteurs classiques, aux rédactions, etc. Mais il est vrai que ce quotidien-là me semblait moins intéressant à raconter dans le livre. D’une part, parce qu’une fois qu’on a raconté une heure de cours, on les a toutes racontées. Mais aussi parce que ces heures « normales », ne sont pas celles pendant lesquelles apparaît la vérité des enfants, leurs vies, leurs pensées, leurs questions, leurs craintes, leurs espoirs… Raconter un élève qui lit du Molière n’a de sens que si ce gamin est amoureux de la littérature ou au contraire si c’est un enfant qui est dans une attitude de défiance vis-à-vis du livre.
En complément, j’ajouterai que ce qui me marque le plus ce ne sont pas des situations particulières (comme nos échanges après les attentats par exemple), mais les trajectoires des élèves. Croiser dans un couloir un enfant qu’on a connu en 6e, réfractaire à tout et le découvrir, 3 ans plus tard, épanoui, heureux, poli, agréable… Ou, au contraire, constater qu’un gamin sur lequel on croyait pouvoir bâtir des perspectives heureuses a, pour une raison que l’on ignore, lâché prise… voilà qui me touche beaucoup.
Vous semblez faire preuve d’une inépuisable bienveillance pour vos élèves qui ne sont pourtant pas tous des « élèves modèles »…
Je me sens, en effet, très à l’aise avec ces enfants de banlieue aux vies souvent compliquées, sans doute parce que j’étais moi-même un élève turbulent ! C’est vrai, qu’au tout début, les bavardages, conflits, insolences… me « bouffaient » ; j’y accordais trop l’importance. J’ai « corrigé ma copie » et choisi de diriger mon regard vers ce qu’il y avait de beau.
Concernant la dimension de bienveillance, je ne pense pas qu’il puisse y avoir de débats. Ce sont des enfants, donc nous avons un devoir de bienveillance en tant qu’adultes tout simplement. Les questions qu’ils nous posent, nous avons pu les formuler, aussi ; les âneries qu’ils font, nous les avons faites aussi. Le manque de respect ? Cela a pu nous arriver. Même si un comportement semble outrancier, une question provocatrice, je laisse toujours à l’enfant le bénéfice du doute… et je lui explique. Peut-être n’acceptera-t-il pas ma réponse, mais peut-être fera-t-elle son chemin. Au moins, se souviendra-t-il que quelqu’un a tenté de lui apporter une réponse, poliment, sans se moquer, sans s’énerver, sans s’impatienter. C’est ça être prof, non ?




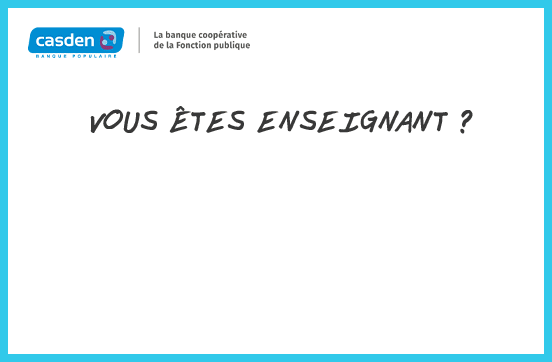



Modération par la rédaction de VousNousIls. Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit adressez-vous à CASDEN Banque Populaire – VousNousIls.fr 1 bis rue Jean Wiener – Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2.